C’était l’une des toutes dernières fois que Tino Rossi regardait le soleil et la mer, ces amants éternels. C’était l’une des toutes dernières fois qu’il se réchauffait aux flammes de l’été. C’étaient ses ultimes regards sur le golfe et sur les Iles Sanguinaires. C’étaient ses adieux à Ajaccio. Il ne le savait pas. Moi non plus. Il s’est avancé vers moi – chemise blanche, pantalon blanc, mocassins blancs - comme s’il entrait sur la scène du Casino de Paris, je veux dire de cette même démarche à la fois tranquille et déterminée qu’on lui connaissait depuis ses débuts au music-hall. « Un monument en marche » avait établi Sacha Guitry. Je remarquai la montre-bracelet en or qu’il portait à son poignet gauche ; était-ce celle que lui avait offerte la veuve Moineau ? Son sourire mettait dans ses yeux la lumière chaude d’un bonheur tranquille. À regarder de près il avait ce sourire commun à beaucoup d’hommes de son âge - Roger Hanin a un peu ce sourire dans les derniers épisodes de Navarro -, à cause des implants, je suppose. Nous nous sommes installés dans le jardin que chahutaient une brise légère et la rumeur des vagues. Une secrète plénitude se révélait à nous. Marcel Pagnol, qui avait du génie, lui avait dit que le mot Scudo venait du latin scutum et signifiait bouclier. J’espérais que Tino me raconterait sa vie. Il m’en fit le résumé riche, ce devait être un jour de grâce, emporté par des souvenirs que nous ravivions (« Je ne vais tout de même pas vous raconter ma vie »). L’évocation de la mort témoigne de la profondeur de notre entretien. « La mort ? Oui, bien sûr, j’y pense, surtout maintenant que je vieillis. Mais, que voulez-vous, lorsque je me réveille et que je vois le golfe d’Ajaccio, j’oublie. » Cette phrase fera l’ouverture de tous les journaux de France Inter le 27 septembre 1982, le jour où l’on apprit son décès. Je revois encore son regard malicieux lorsqu’il m’a dit : « C’est une bonne chute, hein, petit ? » J’avais tourné autour du pot avant de bredouiller mon « La mort vous fait-elle peur ? ». Lui, rayonnant, Le marchand de soleil ! m’offrit une réplique d’opérette. Cependant j’eus ces mots malheureux, qui lui firent mal : « Jusqu’à quand comptez-vous chanter ? » Oui, Tino a eu mal, comme un boxeur a mal lorsqu’il encaisse un crochet au foie. Je le vis blêmir, se décomposer. Un lourd silence s’installa. Il dit enfin, d’une voix hésitante : « Écoutez, je ne sais pas… je ne sais pas. Pour l’instant, ça va. Je me sens bien. » Encore le silence. Et, plus sèchement cette fois : « Ça viendra toujours assez tôt ! » J’aurais dû m’en douter, on ne badine pas avec les choses de l’âme, amer péché de jeunesse. Pour Tino, la mort, oh ! pas une idée vague de la mort, pas cette mort abstraite et encore lointaine dont on s’accommode plus ou moins, non, la mort regardée en face, que l’on perçoit soudainement dans son imminence, dans son irrémédiable, eh bien, cette perspective effroyable, qui glace le sang, pour Tino, s’ouvrait à l’idée de cesser de chanter.
Constant Sbraggia




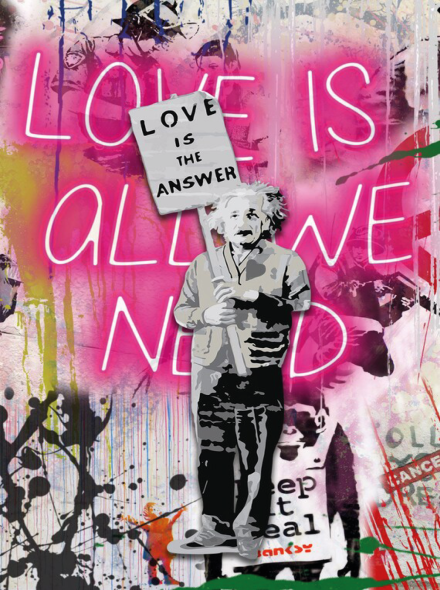







Recent Comments